L’essor de la recherche TRM
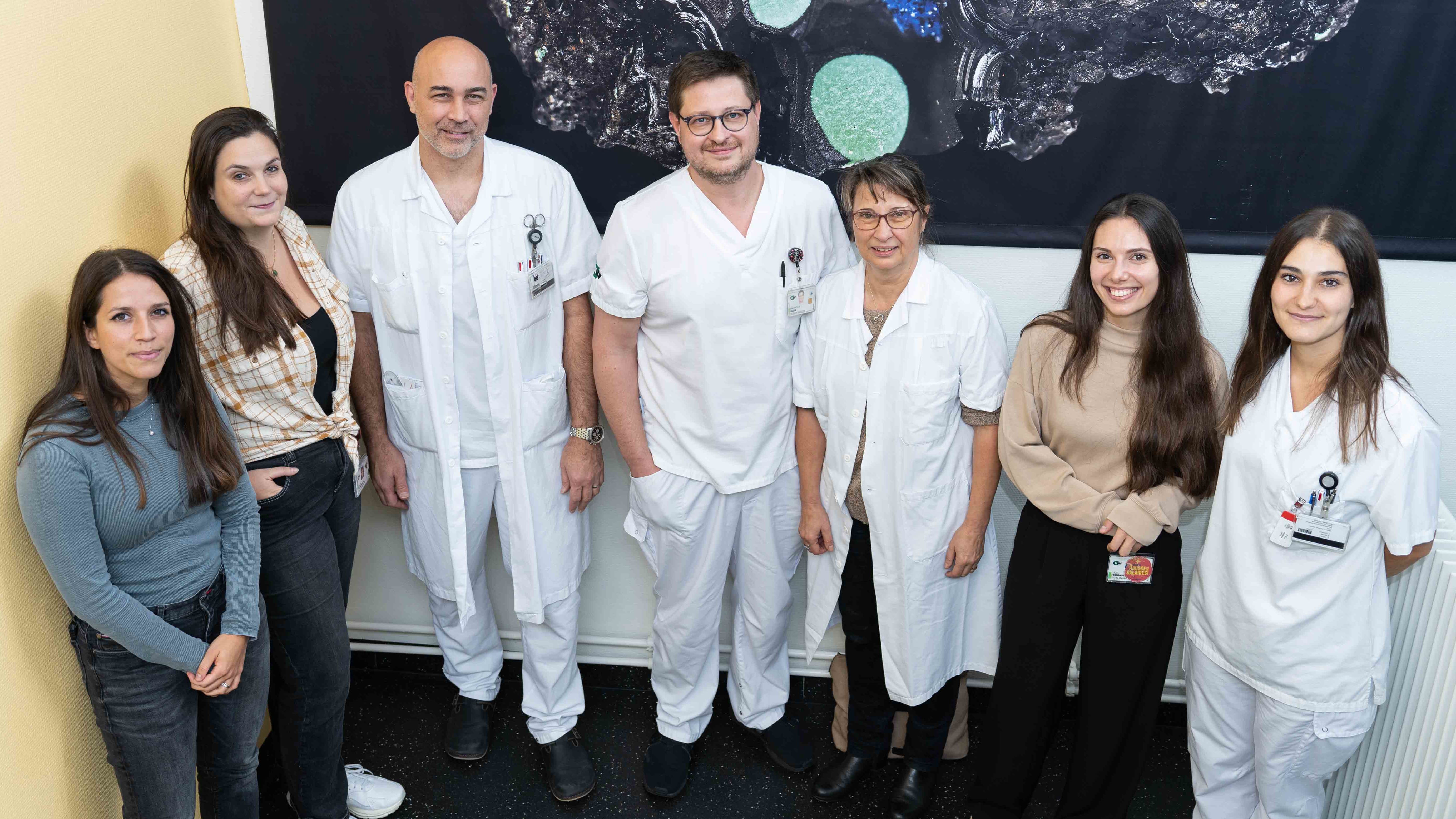
Au cœur de la prise en charge des patients en imagerie, les technicien-nes en radiologie médicale (TRM) jouent un rôle croissant dans la recherche scientifique et l’innovation clinique. Grâce à l’évolution de leur formation et à l’introduction du Master en sciences de la santé, leur implication dans le domaine de la recherche s’est intensifiée ces dernières années. C’est notamment le cas au Service de radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle du CHUV, où une dizaine de TRM participent activement à des études, dont certaines en tant que premiers auteurs. Décryptage de cette tendance avec Marianna Gulizia, TRM MSc coordinatrice de recherche.

Marianna Gulizia, comment percevez-vous l'évolution du rôle des technicien-nes en radiologie médicale (TRM) dans la recherche en Suisse ?
L’introduction du master en sciences de la santé en 2017 a été un tournant important dans le développement des activités de recherche pour les TRM en Suisse romande. Cette formation nous permet d’acquérir de nouvelles compétences, notamment en méthodologie de recherche et en statistiques, facilitant ainsi notre intégration dans des projets de recherche existants tout en renforçant notre capacité à initier nos propres études.
Grâce au master, notre contribution à la recherche a évolué pour s’inscrire dans des étapes clés du projet, telles que la rédaction des protocoles soumis aux comités d’éthique ou encore la rédaction des manuscrits scientifiques. Cependant, bien que ces avancées soient prometteuses, elles restent limitées par un manque de moyens, ce qui freine le plein développement de nos activités de recherche.
Quelle a été l’ampleur de l’activité de recherche menée par les TRM du Service de radiologie diagnostique et interventionnelle du CHUV, l'année passée ?
En 2024, 24 articles ont été publiés dans des revues internationales, impliquant la participation de huit TRM du service, dont huit articles avec un TRM en premier auteur.
« Être premier auteur valorise notre expertise et renforce notre légitimité comme acteurs essentiels de la recherche en radiologie médicale. »
Que représente pour vous le fait que huit de ces publications aient été réalisées avec des TRM en premier auteur ?
C’est un signe fort de l’implication croissante des TRM dans la recherche scientifique. Être premier auteur met en évidence notre capacité à conduire des projets de recherche en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires, en utilisant des outils avancés en recherche, et à contribuer activement à l'avancement des connaissances dans notre domaine. Cette reconnaissance dans des revues internationales valorise notre expertise et renforce notre légitimité en tant qu'acteurs essentiels de la recherche TRM. Cela contribue à accroître la reconnaissance de notre profession dans le milieu académique et médical.
Quels domaines de recherche sont particulièrement en lien avec l’activité des TRM ?
Principalement ceux liés à la prise en soin du patient et l'optimisation des techniques d'imagerie. Par exemple, en 2024, nous avons conduit une étude portant sur l’optimisation des volumes de produit de contraste iodé injecté lors des suivis oncologiques par scanner. Les résultats ont permis de réduire la quantité de produit administrée, avec un impact direct sur la pratique clinique : amélioration de la sécurité des patients, diminution des coûts des examens et contribution favorable à la démarche écoresponsable.

Au-delà des médecins radiologues, avec quels autres spécialistes collaborez-vous dans vos projets de recherche ?
Nous collaborons aussi régulièrement avec des physiciens médicaux. Leur expertise en radioprotection, en optimisation des protocoles d’acquisition et en validation technique est indispensable pour assurer la rigueur méthodologique et la fiabilité des résultats obtenus. Les physiciens médicaux assurent et soutiennent la conception de méthodes et de protocoles d'étude rigoureux, fondés sur des principes physiques souvent méconnus ou non maîtrisés par les TRM. Ce partenariat enrichit la qualité de nos travaux en assurant une approche scientifique rigoureuse et une intégration des dernières avancées technologiques. Grâce à leur expertise, nos recherches gagnent en précision et en pertinence clinique.
Quels sont selon vous les prérequis nécessaires pour le développement d'une activité de recherche TRM dans un service de radiologie ?
Il est essentiel de bénéficier d’un soutien hiérarchique, comme c’est le cas au CHUV ainsi que d’une collaboration renforcée avec la direction des soins. Cela permet de favoriser un environnement propice au développement de la culture académique. Il est également crucial que les TRM impliqués en recherche soient fortement motivés et pleinement investis dans les activités de recherche, car leur engagement personnel est essentiel pour la réussite et la pérennité des projets scientifiques. Toutefois, le véritable défi reste le financement. Nous devons être en mesure d’assurer et d’enrichir des parcours académiques solides afin de pouvoir, à terme, soumettre des demandes de financement auprès des différentes institutions, telles que le FNS et diverses fondations.
« Un soutien de la hiérarchie, comme c’est le cas au CHUV, est primordial pour développer une activité de recherche TRM dans un service de radiologie. »
Quelles stratégies envisagez-vous pour renforcer encore la production scientifique des TRM et assurer un transfert de connaissances efficace vers la pratique clinique ?
Il est important de développer une collaboration directe avec des institutions telles que les hautes écoles, ainsi qu'avec d'autres hôpitaux et cliniques privées. Travailler sur une synergie inter-institutionnelle permettrait non seulement de créer des liens solides entre la recherche et la pratique clinique, mais aussi de favoriser le partage de savoir-faire et de compétences entre professionnels aux expertises complémentaires. Ces collaborations, tant inter-institutionnelles qu'interprofessionnelles, permettraient de créer de nouvelles opportunités de recherche et favoriseraient le partage ainsi que la mutualisation des ressources et des expertises propres à chaque structure.
Concernant le transfert de connaissances vers la pratique, cela nécessite une collaboration interne étroite entre les différents acteurs cliniques, tels que les TRM, chefs TRM, les radiologues, les référents techniques et les physiciens médicaux. Enfin, pour assurer une diffusion externe efficace, il est essentiel que les TRM présentent leurs travaux lors de congrès nationaux et internationaux, tout en poursuivant la publication de leurs recherches dans des revues scientifiques spécialisées.



